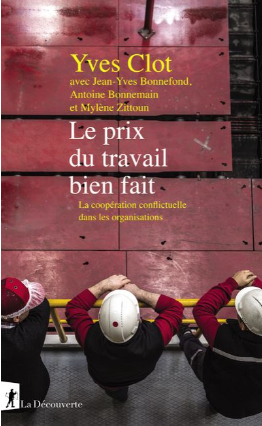28 Jan Mathilde Icard, cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée, DGAFP
« Les conflits peuvent être source de vitalité et il est sain (…) de les traiter plutôt que de les étouffer ou de les régler par un rapport de force. »

Qu’est-ce qui vous a amené à orienter votre parcours professionnel vers le champ des relations sociales ?
Parce que les relations sociales sont le fondement de la vie et que je suis, depuis toujours, ancrée dans la vie ! je suis persuadée – et j’en ai fait l’expérience – que les coopérations doivent être au cœur de toute action. Cette boussole s’explique par mon héritage familial et les rencontres que j’ai pu faire lors de mes études – je pense à des enseignants inspirants lors de mes études en droit public comme à l’INET après ma réussite au concours d’administratrice territoriale, être en relation, en interconnexion c’est l’ADN des territoriaux. Et depuis 20 ans, engagée dans le service public, je n’ai cessé d’approfondir le champ des relations sociales notamment au travers de mes multiples fonctions RH, et de mes dialogues avec le monde de la recherche.
Y a-t-il des faits marquants, des réalisations dont vous êtes particulièrement fière ?
Je suis fière de servir l’intérêt général, j’ai choisi de devenir fonctionnaire et de le rester depuis. Les réalisations sont multiples et toujours collectives ; fière d’avoir contribué à la qualité du service public local lors de mes fonctions de cadre supérieure dans les collectivités territoriales, d’avoir cheminé aux côtés d’élus et de partenaires syndicaux engagés et aujourd’hui de contribuer aux politiques RH pour la fonction publique.
S’il fallait retenir un seul fait, ce serait la recherche-action avec Yves Clot, Jean-Yves Bonnefond, Antoine Bonnemain et les équipes de la ville de Lille lorsque j’étais directrice générale adjointe chargée des RH. Cette expérience m’a profondément transformé, elle a été possible grâce au « terreau fertile » au sein de la collectivité. A cette époque, lorsque je prends mon poste, la question des taux d’absentéisme plane notamment au sein de la direction de la propreté publique qui a conduit une démarche de diagnostic et de plan d’actions sans réel résultat. La ville de Lille a expérimenté à partir de fin 2016 dans le cadre d’un partenariat avec le CNAM avec la mise en place d’un dialogue professionnel sur la qualité du travail à la direction de la propreté publique. Cette expérimentation sociale a été testée sur un secteur de la ville puis déployée sur l’ensemble des secteurs puis au secteur de la petite enfance.
La 1ère phase a permis de conduire une analyse du travail basée sur l’activité réelle. Les agents sont observés, filmés. Les films sont ensuite partagés entre pairs. Les points de vue sur le travail se confrontent (comment je passe mon balais, par quelle route je passe, comment faire pour que les rats ne restent pas dans les containers…). Le point de vue du collectif est ensuite discuté avec « la direction ». Le débat sur les critères de la qualité du travail est alors institué.
Ce dispositif a donné naissance à une nouvelle fonction : les référents métiers. Agents de la propreté, désignés par leurs pairs, les référents sont chargés sur le terrain de recenser les problèmes rencontrés au quotidien et de discuter avec la direction des problèmes. Le dispositif est très cadré car pour que le dialogue tienne, il faut des processus organisés avec un rôle central des organisations syndicales. La collaboration avec le CNAM m’a en effet appris que la parole n’est libre que lorsqu’elle est contrainte autour des bons objets. Ce dispositif a permis de changer plusieurs outils de travail et d’améliorer la qualité du service rendu. Je pense aussi que la réforme des cycles de travail que la collectivité a conduit par la suite n’aurait pas été la même sans cette expérience. Il y a eu des mouvements au début : j’ai en tête les préavis de grève lorsque nous réunissons avec le DGA concerné les équipes pour présenter la réflexion ; des débats en CHSCT intenses.
Comme tout organisme vivant, j’ai toujours pensé que les collisions, les conflits peuvent être source de vitalité et qu’il est plus sain de mettre en place un dispositif permettant de les traiter plutôt que de les étouffer ou de les régler par un rapport de force. Ma vision et ma pratique du dialogue social ont aussi été transformées par cette expérience.
Vous êtes adhérente de l’association Réalités du dialogue social dont la vocation est de promouvoir le dialogue social. Pourquoi est-ce si important pour vous ?
L’association Réalités du dialogue social crée les conditions d’un échange riche et constructif, nous pouvons partager nos expériences, les façons de pratiquer le dialogue social, nous pouvons croiser les points de vue, et construire des ressources communes, bref un lieu d’une grande vitalité ! A titre personnel, la diversité des profils des adhérents et la qualité des débats me font progresser dans ma réflexion et mon action.
Avez-vous vu un film, écouté un podcast ou lu un livre que vous recommanderiez à la Communauté Réalités du dialogue social ?
Je cultive ma réflexivité par la lecture, les dialogues et je suis amatrice de podcasts. Ma bibliothèque est bien fournie et j’ai de nombreuses recommandations. Mais puisqu’il faut se limiter à une, je retiens, Le prix du travail bien fait d’Yves Clot, Jean-Yves Bonnefond, Antoine Bonnemain et Mylène Zittoun, ed. La Découverte, qui, au travers de trois exemples (dont celui que j’ai vécu à Lille), explique comment s’essayer à la coopération conflictuelle dans les organisations, source de qualité du travail.